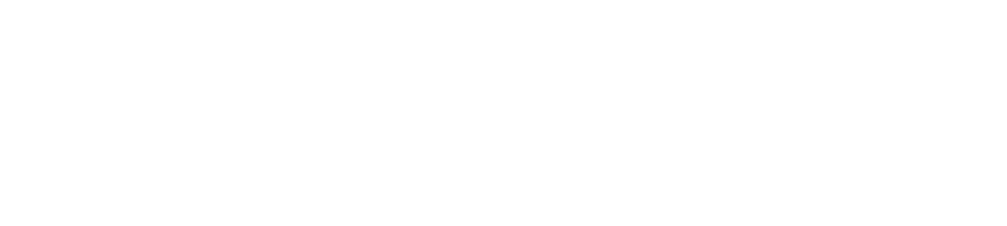Le prochain arrêt de la Cour de justice de la République (CJR) améliorera-t-il sa réputation ? Alors que le procès pour conflit d’intérêts d’Éric Dupond-Moretti s’est achevé, jeudi 16 novembre, au terme de dix jours d’audiences qui auront vu pour la première fois de l’histoire de la Ve République un ministre de la Justice être jugé dans l’exercice de ses fonctions, la question est dans toutes les têtes. La décision de la CJR sera rendue le 29 novembre.
Si le procureur général de la Cour de cassation Rémy Heitz a requis, mercredi 15 novembre, une peine “juste et significative” d’un an de prison avec sursis contre le garde des Sceaux, “coupable” de prise illégale d’intérêts, de “façon nette et tranchée”, les statistiques jouent en faveur de la défense : sur treize jugements rendus en trente ans d’existence, la CJR a ordonné six relaxes, deux condamnations assorties d’une dispense de peine, cinq condamnations de prison avec sursis et aucune condamnation à de la prison ferme.

Créée en 1993 dans le contexte de l’affaire du sang contaminé, la Cour de justice de la République a pour mission de juger les membres du gouvernement pour les délits ou les crimes commis dans l’exercice de leur fonction. Sa naissance devait permettre, en théorie, de mettre fin aux polémiques incessantes à cette époque sur une supposée impunité des ministres. Trente ans plus tard, cette juridiction spécialisée fait l’objet de vives critiques, aussi bien de la part de politiques que d’avocats ou de magistrats.
“C’est vrai que la CJR souffre de problèmes structurels, le plus important étant selon moi qu’elle se saisisse d’actes de la fonction ministérielle au moyen d’une procédure pénale”, estime Cécile Guérin-Bargues, professeure de droit public à l’Université Paris II Panthéon-Assas et autrice de “Juger les politiques ? La Cour de justice de la République” (éd. Dalloz, 2017). “Le fait que le ministre n’ait pas exercé ses compétences comme il aurait dû le faire relève de la responsabilité politique, ajoute-t-elle. Les décisions politiques devraient être jugées par le politique, par l’intermédiaire d’une commission d’enquête parlementaire par exemple.”
“Une autre difficulté, c’est la disjonction des procédures, poursuit Cécile Guérin-Bargues. La CJR n’est compétente que pour juger les ministres, mais certaines affaires impliquent parfois des complices qui ne sont pas membres du gouvernement. Ceux-ci sont alors jugés par des juridictions ordinaires et cela peut donner lieu à des jugements incohérents, comme dans le cas de Christine Lagarde ou de Charles Pasqua.”
Ce dernier a ainsi été blanchi par la CJR du délit de corruption passive dans l’affaire de la vente du casino d’Annemasse ayant notamment servi au financement de son parti, alors même qu’il avait été condamné précédemment par le tribunal de Paris dans le volet non ministériel de cette affaire et que l’un de ses proches, Michel Tomi a, lui, été condamné par le tribunal de Paris du délit de corruption active.
Des politiques à la fois juge et partie
Le dernier problème majeur est bien évidemment le visage éminemment politique de la CJR. Sur les quinze juges qui la composent, trois sont des magistrats de la Cour de cassation – Dominique Pauthe, Ingrid Andrich, Sylvie Ménotti – et douze sont des parlementaires. Parmi eux, on trouve six sénateurs – Catherine Di Folco et Gilbert Favreau (Les Républicains), Jean-Luc Fichet (Parti socialiste), Jean-Pierre Grand (Horizons), Thani Mohamed Soilihi (Renaissance), Évelyne Perrot (Union centriste) – et six députés – Émilie Chandler et Didier Paris (Renaissance), Laurence Vichnievsky (MoDem), Philippe Gosselin (Les Républicains), Danièle Obono (La France insoumise) et Bruno Bilde (Rassemblement national).
À la lecture de la composition de la CJR, deux constats sautent aux yeux : un ministre mis en cause se retrouve jugé par ses pairs ; et parmi eux, ce sont cinq élus de la majorité présidentielle et quatre élus de la droite avec lesquels le gouvernement tente de travailler depuis le début de la législature qui vont participer au jugement d’Éric Dupond-Moretti.
De quoi installer, au choix, un soupçon de complaisance ou de règlement de compte “tout aussi mauvais l’un que l’autre”, selon la spécialiste, “car on aboutit dans les deux cas à une politisation de la justice”.

De fait, le soupçon est bien installé : la Cour de justice de la République a la réputation de prononcer des peines plutôt clémentes à l’encontre des ministres. Elle a ainsi consacré le concept du responsable mais pas coupable et a même prononcé une dispense de peine à l’encontre de deux ministres, Edmond Hervé et Christine Lagarde, pourtant jugés coupables.
Au-delà de sa composition, le fonctionnement de la CJR pose également question : ses décisions, rendues par vote à bulletin secret, ne sont pas susceptibles d’appel et les plaignants ne peuvent pas se constituer partie civile. Par ailleurs, des témoins peuvent ne pas prêter serment.
La suppression de la CJR maintes fois évoquée
Il n’est donc pas étonnant que reviennent régulièrement les appels à supprimer la Cour de justice de la République. Chaque nouvelle affaire donne lieu à la publication de nombreuses tribunes demandant à mettre fin à ce qui est considéré par beaucoup comme une justice d’exception. L’une des dernières en date, publiée mercredi dans Le Monde, a été écrite par l’avocat Vincent Brengarth.
“Le maintien de la CJR tranche avec le devoir d’exemplarité que réclament encore davantage les hautes fonctions de l’État, écrit-il. La période, qui connaît une croissante fragilisation de la parole publique notamment du fait de la prolifération des ‘affaires’, mérite mieux qu’une justice d’exception synonyme d’une clémence institutionnalisée. Supprimons enfin la CJR.”
La classe politique a toutefois conscience du problème. François Hollande, en 2012, comme Emmanuel Macron, en 2017, ont promis durant leur campagne électorale de supprimer la CJR, en vain. De même, la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique présidée par Lionel Jospin avait aussi préconisé, en novembre 2012, sa suppression. Et plus récemment, ce sont les États généraux de la justice qui en ont fait autant dans un rapport publié en juillet 2022.
“Supprimer la CJR implique une révision constitutionnelle toujours compliquée à mener, souligne Cécile Guérin-Bargues. Et par ailleurs, il faut savoir qu’elle a été submergée de plaintes après le Covid-19. Les citoyens se sont emparés d’elle. Il faudra donc faire preuve de pédagogie pour faire comprendre pourquoi elle ne fonctionne pas bien.”
La CJR a en effet reçu 246 plaintes en 2020, dont 164 en lien avec la gestion de la pandémie, puis 20 199 en 2021 – la quasi-totalité concernant là encore le Covid-19 ou la mise en place du passe sanitaire – et 372 en 2022. Des chiffres jamais atteints annuellement auparavant.
Après réception, ces plaintes sont filtrées par une commission des requêtes, puis examinées par une commission d’instruction, toutes deux formées de magistrats. Et à l’issue de l’instruction, cette commission prononce un non-lieu ou un renvoi en procès.
Au moins trois informations judiciaires y sont actuellement en cours. Celle, depuis juillet 2020, sur la gestion du Covid-19 par Édouard Philippe, Agnès Buzyn, tous deux placés sous le statut de témoin assisté, et Olivier Véran. Des investigations portent également depuis juillet 2022 sur la suspension possiblement discriminatoire d’un policier converti à l’islam ordonnée par l’ex-ministre de l’Intérieur Christophe Castaner. Enfin, l’actuelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, fait l’objet d’une procédure depuis le 21 juin, après la plainte en diffamation de l’ex-patron du football français, Noël Le Graët, pour des propos tenus sur la gestion de sa fédération.